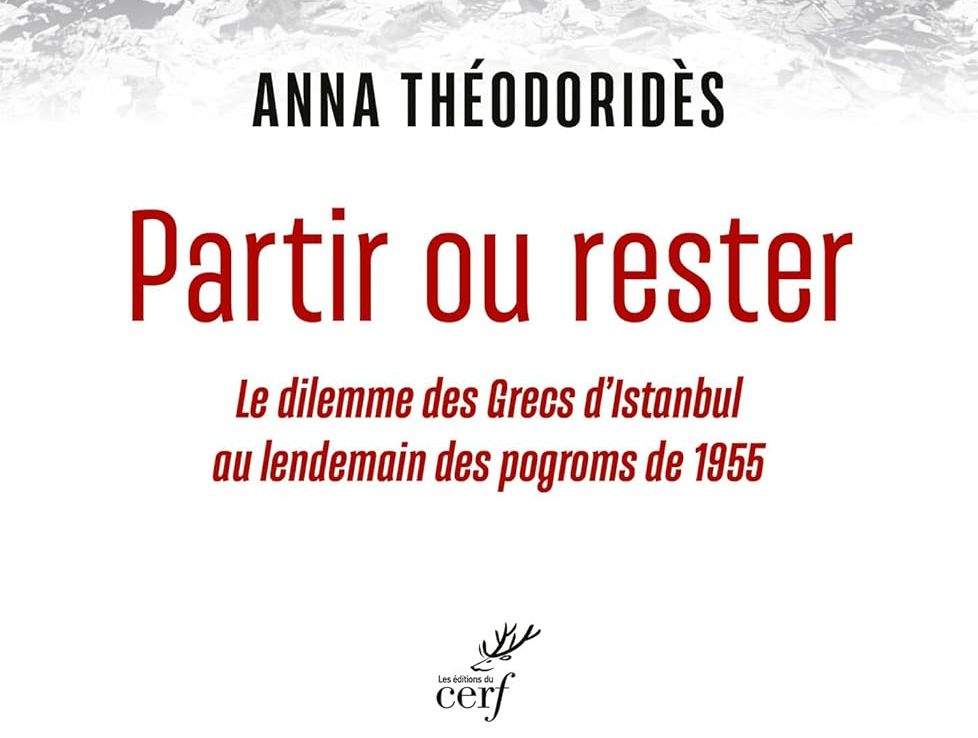Anna Théodoridès, Partir ou rester. Le dilemme des Grecs d’Istanbul au lendemain des pogroms de 1955, éditions du Cerf, 2025, 332 pages, 35 euros.
Cet ouvrage d’histoire d’Anna Théodoridès, docteur en sociologie de l’École des hautes études en sciences sociales, spécialiste des sociétés en Méditerranée orientale, s’ouvre sur le récit d’une mémoire. La personne qui témoigne était alors une petite fille qui fêtait ses six ans à Istanbul, avec sa famille, dans la nuit du 6 au 7 septembre 1955. Brutalement tout bascula. Une parente avertit la famille de se cacher de toute urgence, peu après « un craquement assourdissant a résonné dans la maison » (p.13), la porte avait cédé. Une troupe d’hommes en furie entra alors, dévastant tout sur son passage. Le père fut trouvé tandis que le reste de la famille terrorisé demeurait caché, mais entendait tout : « Les hurlements déchirants de mon père se mêlaient aux bruits sourds des coups portés avec une cruauté sans limite. » (p. 14) Cette terreur, accompagnée de destructions et de nombreuses violences, a été vécue par la communauté grecque orthodoxe d’Istanbul au cours de cette terrible nuit. Ce pogrom était dirigé principalement contre les Grecs d’Istanbul, ces « Rûms polites » ou, nous dit aussi l’auteure, ces « Polites », héritiers d’une histoire plurimillénaire et des fondateurs de la grande ville chargée d’histoire. C’est le destin de cette communauté au XXe siècle qu’approfondit cet ouvrage : « Entre fuite et enracinement, silence ou expression publique, refus, dans tous les cas, d’être de simples victimes sacrificielles des tensions entre la Grèce et la Turquie, ce sont les stratégies de résistance des Grecs d’Istanbul que ce livre souhaite mettre en lumière. » (p. 19) Il propose une étude du « fait minoritaire sous le prisme de l’expérience » (p.317). Si le livre commence par un récit poignant, il se poursuit comme une vaste enquête historique et sociologique menée en différents lieux, notamment à Istanbul, à Athènes et à Thessalonique. Parmi les différents aspects abordés par l’ouvrage figure le lien consubstantiel de la communauté grecque avec le Patriarcat œcuménique. Il est, nous dit Anna Théodoridès, « le principal acteur sur lequel la communauté continue de se fixer. […] Temps religieux et temps social se confondent » (p.26).
Le pogrom de 1955 s’inscrit dans la continuité d’une politique nationaliste turque désireuse d’uniformiser et de turquiser la population. Dès lors les communautés grecques, ainsi que d’autres (les Arméniens et les Juifs), sont poussées à l’exil, parfois lors de secousses brutales. L’auteure examine en détail l’histoire et les conséquences de cette politique qui se déploie au XXe siècle. À Istanbul au début du XXe siècle (alors encore Constantinople), la communauté grecque de la ville était estimée à environ 30 % de la population stambouliote, soit approximativement 330 000 membres. Elle est aujourd’hui bien en dessous des 1 % avec quelques milliers de personnes alors qu’elles étaient encore près de 80 000 (d’autres chercheurs donnent le chiffre de 135 000) en 1955 ! Ces départs ont lieu à la suite de graves crises, comme les évènements tragiques de la nuit du 6 au 7 septembre 1955. Le bilan de celle-ci est très lourd : une quinzaine de personnes ont été tuées (dont un prêtre brûlé vif), des dizaines furent grièvement blessés, des centaines de viols ont eu lieu, des prêtres ont été circoncis, des tombes, dont celles de patriarches orthodoxes, furent profanées ; les conséquences matérielles sont également considérables, des milliers de bâtiments sont détruits ou vandalisés, dont 73 églises, deux monastères, 26 écoles (p.64). Les chercheurs établissent qu’environ 100 000 personnes ont participé à ces atrocités et à ces destructions.
C’est un ouvrage qui est le fruit d’une longue et méticuleuse recherche sur les tourments endurés par une minorité héritière d’une longue et prestigieuse histoire. Il ne manquera de susciter l’attention et l’intérêt mérité de tous ceux qui désirent en savoir plus sur la presque totale disparition des Grecs d’Asie Mineure et de la région de Marmara au XXe siècle après des millénaires de présence active. Dans sa conclusion, l’auteure propose de reprendre les grands enseignements de ses travaux pour les appliquer à d’autres minorités chrétiennes malmenées au Proche et Moyen-Orient. Dans ce livre, elle apporte de nombreux éclairages sur cette histoire méconnue et relate précisément les stratégies mises en place, comme la résistance ou la fuite vers des horizons incertains pour survivre. Comment ne pas disparaître ? Malgré tout.
Christophe Levalois