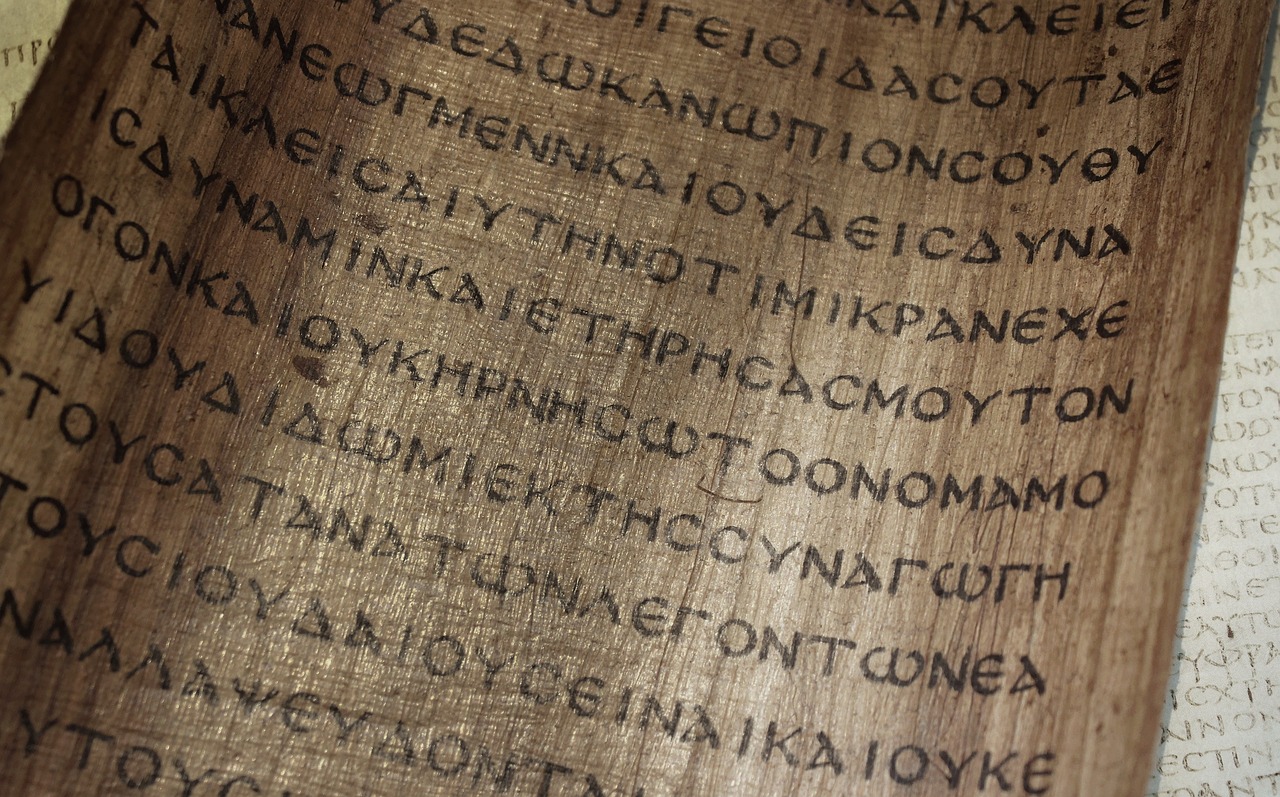Cet article continue la série des textes basée sur les six volumes de « Jésus-Christ. Vie et Enseignement » par le métropolite Hilarion Alfeyev que vous trouverez tous les vendredis depuis cette page. Au fil de cette série, nous nous immergerons dans l’univers de la vie et des enseignements de Jésus-Christ, fidèlement conservés au sein de la religion chrétienne et notamment dans la tradition orthodoxe. Ensemble, nous entreprendrons un voyage de redécouverte de la personnalité de Jésus qui a une influence profonde sur notre monde et qui continue de le modeler à travers les âges.
Tout au long du 20e siècle, la théorie la plus répandue sur l’interdépendance entre les trois Évangiles synoptiques (Matthieu, Marc, et Luc) était celle des « deux sources ». Selon cette théorie, les Évangiles de Matthieu et de Luc auraient été basés sur l’Évangile de Marc ainsi que sur une source hypothétique initialement appelée « source Q ».
L’Évangile de Marc est-il la première source écrite?

Jusqu’au milieu du 19e siècle, l’Évangile de Matthieu était considéré comme le plus ancien. Mais, depuis le 20e siècle, la majorité des chercheurs tendent à voir l’Évangile de Marc comme le premier rédigé, servant ainsi de source pour Matthieu et Luc.
Pour appuyer cette hypothèse, les spécialistes pointent la concordance entre Matthieu et Luc avec la chronologie des événements de Marc, mais leur divergence dans les segments absents chez Marc. Cette observation suggère que l’Évangile de Marc, le plus concis avec seulement 661 versets comparé à 1068 pour Matthieu et 1149 pour Luc, est probablement le premier à avoir été composé, marquant le passage de la tradition orale à la tradition écrite.
Une autre preuve de l’antériorité de Marc provient de l’analyse comparative des passages parallèles entre Marc et Matthieu, où Matthieu omet certains éléments présents chez Marc qui mettent en lumière les qualités humaines de Jésus, lesquelles pourraient sembler incompatibles avec sa dignité divine. Cela amène à conclure que Matthieu a probablement écrit après Marc, en adaptant son texte pour mieux correspondre aux enseignements de l’Église.
Cependant, cette conclusion dépend de l’acceptation préalable de la primauté de Marc. Si l’on partait de l’hypothèse que Matthieu était antérieur, on pourrait alors supposer que Marc, rédigeant après Matthieu, a intégré dans son récit des références aux qualités humaines de Jésus absentes chez Matthieu.
L’hypothèse de la “source Q »
L’hypothèse de la “source Q” a émergé dans les milieux protestants allemands, s’inspirant des écrits de Papias d’Hiérapolis, datant du 2e siècle. Ces écrits ont été rapportés par l’historien du 4e siècle Eusèbe de Césarée, qui a cité Papias disant que «Matthieu a réuni en langue hébraïque les logia (paroles) de Jésus, et chacun les interprétait selon ses capacités».
Cela a mené à la théorie que le proto-évangile de Matthieu était principalement un recueil de discours de Jésus, sans inclure le récit de sa vie, de sa mort ou de sa résurrection.
Cette conception de Q, envisagée comme une collection d’environ 230 sentences de Jésus présentes chez Matthieu et Luc, mais absentes chez Marc, a gagné en influence principalement dans les cercles académiques germanophones et anglophones. Elle est même reconnue par de nombreux théologiens catholiques aujourd’hui.
Selon certaines théories, Q aurait d’abord existé sous forme de tradition orale avant d’être consignée par écrit. Les débats académiques continuent sur la langue originale de Q, sur le lieu et la période de sa mise par écrit, ainsi que sur le genre littéraire auquel elle appartient. Suivant les traces de Papias, certains pensent que Q aurait pu être rédigée initialement en hébreu, puis traduite en grec. Pour tenter de « reconstituer » Q, les chercheurs analysent des éléments tirés de textes apocryphes comme l’Évangile de Thomas.
La “source Q” et le “Jésus historique”

L’adoption de l’hypothèse Q au cours du 20e siècle par la plupart des spécialistes du Nouveau Testament ne découle pas uniquement d’une analyse comparative des trois Évangiles synoptiques. Elle est également liée à l’idée que seuls certains éléments des Évangiles peuvent être attribués au “Jésus historique”, le reste étant le produit des rédacteurs ultérieurs. De ce fait, des efforts considérables ont été déployés pour identifier dans les textes évangéliques les paroles qui pourraient être directement attribuées à Jésus. Pour ce faire, les chercheurs ont analysé minutieusement le texte, le fragmentant pour distinguer le noyau prétendument authentique des ajouts postérieurs.
Le volume de recherche consacré à cette entreprise est considérable. Toutefois, il est important de noter que ces études ne reposent pas principalement sur la critique textuelle du Nouveau Testament, étant donné que tous les chercheurs partent du même corpus textuel. Les conclusions sur l’authenticité des fragments se fondent plutôt sur des prémisses idéologiques, séparant les paroles authentiques de Jésus des récits postérieurs et des interprétations ajoutées par la suite.
Nous n’aborderons pas en détail ici le débat complexe autour de la source Q ou ce qui dans les Évangiles remonte véritablement au Jésus historique. Il est essentiel de reconnaître que ce débat repose largement sur des hypothèses et des conjectures.
Actuellement, des voix dans la communauté scientifique remettent de plus en plus en question la réalité de la source Q, la considérant comme une construction théorique élaborée par des chercheurs désireux de démontrer que Jésus était principalement un enseignant moral dont les enseignements ont été compilés après sa mort.
Dans cette perspective, ce n’est que des décennies plus tard que l’enseignement de Jésus aurait été divinisé et que sa mort aurait été interprétée comme ayant un sens rédempteur. Ces chercheurs auraient ainsi « fabriqué » la source Q en extrayant de manière sélective des phrases des Évangiles canoniques et apocryphes pour appuyer leur thèse.
Mise à jour scientifique sur les Évangiles synoptiques
Il existe aujourd’hui un consensus scientifique concernant certaines données clés sur la corrélation du matériel entre les évangiles synoptiques: 90% du matériel de l’Évangile de Marc se retrouve dans l’Évangile de Matthieu et plus de 50% dans l’Évangile de Luc. De plus, 51 % des passages de l’Évangile de Marc coïncident littéralement avec ceux de Matthieu, et environ 53 % avec ceux de Luc.
Historiquement, au 20e siècle, ces données ont mené les spécialistes à conclure à une dépendance littéraire entre les trois évangélistes, ou à l’existence de sources communes. Toutefois, une analyse statistique moderne apporte de nouvelles perspectives à cette conception.

Le chercheur allemand en Nouveau Testament, Eta Linnemann, fournit des chiffres précis: l’Évangile de Marc comprend 116 péricopes, dont 40, totalisant 3635 mots, ne présentent aucun parallèle chez Matthieu et Luc, ce qui représente 32,28 % de tout l’Évangile de Marc. Les 76 péricopes restantes, comprenant 7625 mots et ayant des parallèles chez Matthieu et Luc, représentent 67,72 % de l’Évangile de Marc. Parmi ces 7625 mots, 1539 sont parfaitement identiques dans les trois Évangiles (20,19 %), 1640 identiques entre Matthieu et Marc (21,51 %), 877 entre Marc et Luc (11,5 %), et 381 entre Matthieu et Luc (5 %). Sur les 1539 mots identiques dans les trois synoptiques, seulement 970 mots peuvent être considérés comme sémantiquement identiques, représentant 12,72 % du total des mots dans le matériel commun.
À partir de l’analyse objective du texte, le chercheur conclut qu’il n’y a pas de raison suffisante pour affirmer une interdépendance littéraire stricte entre les trois Évangiles.
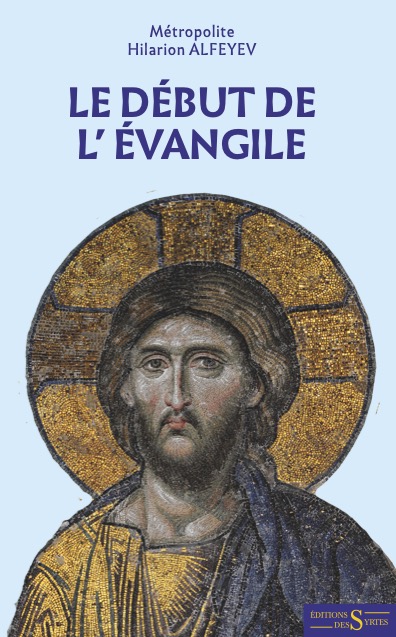
Pour illustrer cela, il suffit de mener une expérience simple: demander à trois personnes qui ne se connaissent pas de décrire un événement observé, comme un accident de la route. Leurs descriptions présenteront des similitudes, telles que les termes utilisés (« la route », « la voiture », « le conducteur », « la collision »), mais aussi des différences significatives dans la manière de raconter l’événement, sans que cela implique une dépendance littéraire ou une relation entre les témoins.
Si le désir de parcourir plus avant les sentiers de l’impact historique et spirituel de Jésus-Christ résonne en vous, nous vous suggérons de vous tourner vers le premier volume de “Jésus-Christ. Vie et Enseignement”. Une visite sur le site des Éditions des Syrtes vous ouvrira les portes de Début de l’Évangile. Cette exploration se déroule sous la lumière de la tradition orthodoxe, patristique et liturgique, tout en étant attentivement menée en dialogue avec les perspectives de la critique biblique contemporaine. Dans ce processus, le livre vous encourage à revisiter et à restructurer les informations déjà connues sous une nouvelle lumière. Laissez cette œuvre élargir votre horizon sur la figure de Jésus, vous guidant vers une compréhension plus riche et nuancée, profondément enracinée dans la tradition, tout en restant réceptive aux interrogations et aux avancées de notre époque.